Article : Routes et ouvrages d’art en Corse de l’Antiquité à nos jours
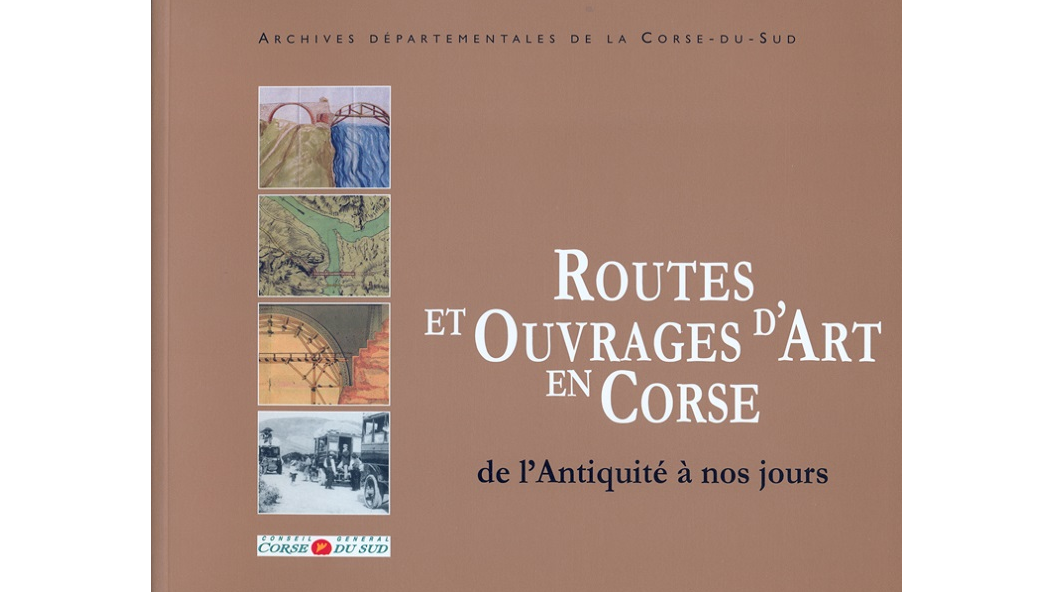
Une publication des Archives départementales de Corse-du-Sud, 2003, 59 pages
Longtemps, les routes en Corse ont été, comme en beaucoup de lieux de la Méditerranée, des routes maritimes. « La Méditerranée, écrivait Lucien Febvre, ce sont des routes », une « surface de transport » ajoutait Fernand Braudel. La Corse, placée sur l’antique route des îles, s’inscrit au sein des grands courants d’échanges dès l’Antiquité, et c’est dans cette optique qu’il faut lire l’existence de la Via corsica sous les Romains ou la représentation d’une Corse plate où tous les points connus sont littoraux. Encore, l’essentiel de la navigation est-il à plus faible rayon, d’un point à l’autre, d’une plage à la prochaine, un cabotage qui lentement s’améliore, se développe et grossit ses effectifs, les Cap Corsins ralliant les Maremmes romaine et toscane au printemps, Bastia et la Plaine Orientale le reste de l’année navigable.
Ce triomphe de voyage à très courte distance est révélé par maints détails : ce sont les barques cap corsines, quelquefois des bateaux des Rivières ligures et au milieu du XVIIe siècle des patrons provençaux qui font la poste de l’île. Et peu de choses changent avec le temps : c’est un véritable cortège de barques, assurant l’essentiel des liaisons utiles à Gênes, qui transparaît dans les journaux de la contre-course génoise, organisée dans les années 1760 pour mettre fin à la course paoliste. Avec cette route maritime coexistent les routes de terre. Routes multiples : chemins littoraux, comme cette voie allant de Bonifacio vers le Cap Corse, par Aleria, la pieve de Mariana et la seigneurie des Bagnara, que parcourt en 1289 l’armée génoise de Luchetto Doria et où plus tard les Turcs viennent s’aposter pour razzier le passant ; étroits et mauvais chemins perpendiculaires, raccordés les uns aux autres, par où l’on accède, faute le plus souvent de pouvoir naviguer les rivières, aux vallées intérieures de l’île et aux différents cols qui permettent de passer les monts ; voies muletières, empierrées et closes de murs, où passent les convois de bêtes de somme. Peu de progrès à attendre dans ce domaine, si ce n’est la multiplication des ponts dans la partie la plus populeuse de l’île – le Nord-Est – la plupart du temps et un meilleur état des routes menant de commune à commune, vérifiées constamment désormais par les podestats et padri del comune, sous la surveillance eux-mêmes des représentants insulaires, les Nobles XII, ou des commissaires extraordinaires génois.
Au moment où la France se substitue à Gênes, le réseau routier carrossable insulaire est inexistant. L’atlas de Bellin, plus tard le Terrier, nous représentent un entrelacs de chemins baptisés très improprement routes, mais sans réelle hiérarchie. Et si la monarchie française pense, pour des raisons essentiellement militaires, créer des voies nouvelles ou élargir les anciennes, les progrès sont peu visibles.
En fait, le réseau routier moderne est le produit de l’action de deux souverains du XIXe siècle, Louis-Philippe et Napoléon III.
C’est sous leur règne que s’effectue la grande mutation de l’espace insulaire avec la création d’une route ceinture autour de l’île et de grands transversales, alors même que la France connaît la première révolution industrielle. La Troisième République verra la création du chemin de fer de la Corse. Le XXe siècle sera le siècle des évolutions déterminantes avec la multiplication des véhicules individuels, la décentralisation et l’apparition d’un personnage déterminant : l’usager.
Références complètes de l’ouvrage

